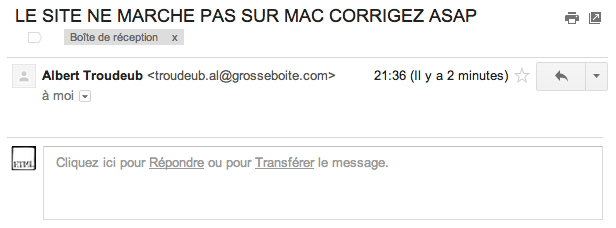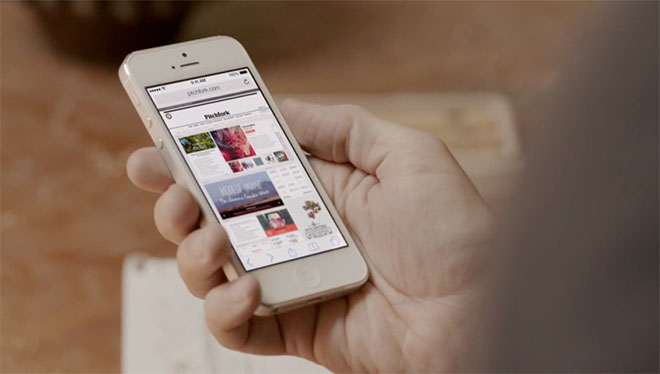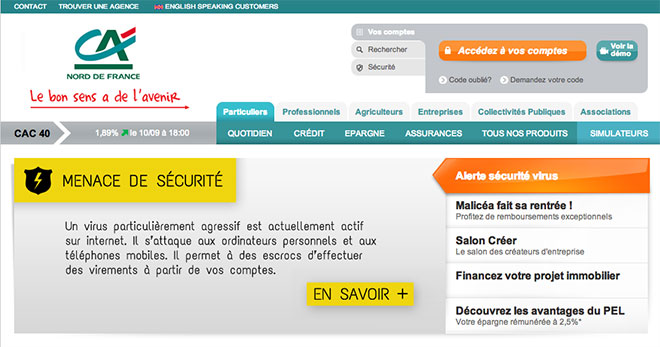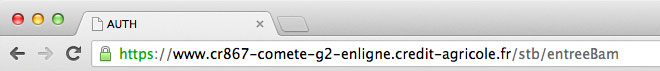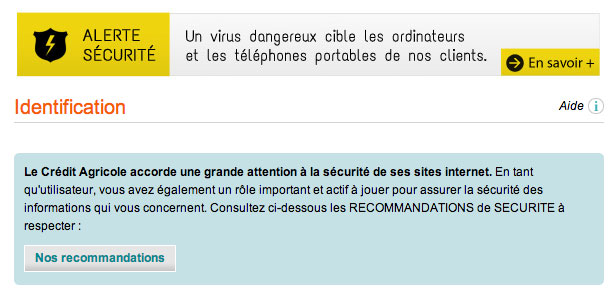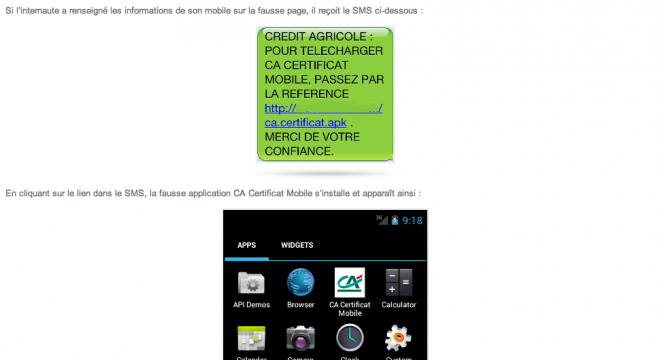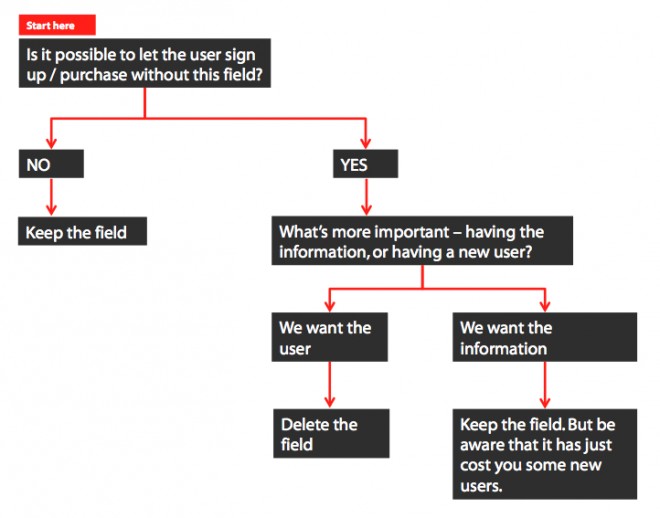« Of course, but maybe… »
Le dernier spectacle de Louis C.K., Oh My God, est vente en ligne sur son site pour cinq dollars. J’ai un amour inconditionnel pour Louis C.K. et ce spectacle est excellent. En particulier ce sketch, « Of course, but maybe… ».
http://www.youtube.com/watch?v=kKXIlufI0ow
Tout le monde a une rivalité dans son cerveau entre des pensées positives et négatives. Idéalement les pensées positives l’emportent. Moi, j’ai toujours les deux. Il y a le truc auquel je crois, le bon truc, et puis il y a ce truc. Je n’y crois pas forcément, mais c’est quand même là. C’est toujours ce truc, et ce truc. C’est devenu une catégorie dans mon esprit que j’appelle « Bien sûr, mais peut-être… ». Je vais vous donner un exemple.
Bien sûr, bien sûr, les enfants allergiques aux noix doivent être protégés. Bien sûr ! Nous devons isoler leur nourriture des noix, avoir leurs médicaments disponibles à tout moment. Et n’importe qui fabrique ou sert de la nourriture doit être au courant des allergies aux noix mortelles. Bien sûr ! Mais peut-être… peut-être que si toucher une noix vous tue, vous êtes censés mourir.
Bien sûr que non, bien sûr que non ! J’ai un neveu qui a ce problème. Je serais dévasté si quoi que ce soit lui arrivait. Mais peut-être… peut-être que si on ferme tous les yeux pendant un an, on en aura fini avec les allergies aux noix pour toujours… Non, bien sûr que non !
Bien sûr, si vous allez combattre dans un autre pays et que vous vous faites tirer dessus, c’est une horrible tragédie. Bien sûr, bien sûr ! Mais peut-être… peut-être que si vous prenez un arme et que vous allez dans un autre pays, et que vous vous faites tirer dessus, ce n’est pas si bizarre. Peut-être que si vous vous faites tirer dessus par le type sur qui vous étiez juste en train de tirer, c’est un tout petit peu votre faute.
Bien sûr, bien sûr, l’esclavage est la pire chose qui ait jamais existé. Bien sûr ! À chaque fois que c’est arrivé ! Les noirs en Amérique, les juifs en Égypte, à chaque fois que c’est arrivé, c’était quelque chose d’horrible. Bien sûr ! Mais peut-être… peut-être que n’importe quel accomplissement incroyable humain dans toute l’Histoire a été fait par des esclaves. Le moindre truc où vous vous dites « Mais comment ont-ils construit ces pyramides ? ». Ils ont juste balancé de la mort et de la souffrance humaine jusqu’à ce que ce soit fini. Comment avons-nous traversé le pays avec des voies ferrées aussi rapidement ? On a juste balancé des chinois dans des caves et tout fait sauter sans se préoccuper de ce qui allait leur arriver. Il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez faire quand vous n’avez rien à secouer d’un certain groupe de personnes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ! C’est de là que vient la grandeur de l’espèce humaine, nous sommes des personnes merdiques.
Même aujourd’hui [en sortant son smartphone], comment avons nous ces merveilleuses technologies miniatures ? Parce que dans les entreprises où ils font ça les employés sautent du putain de toit parce que c’est un cauchemar là-bas. Vous avez le choix pourtant. Vous pouvez avoir des bougies et être un peu plus gentil les uns avec les autres. Ou alors laissez quelqu’un souffrir incommensurablement très loin d’ici pour que vous puissiez laisser un commentaire méchant sur Youtube pendant que vous faites caca.