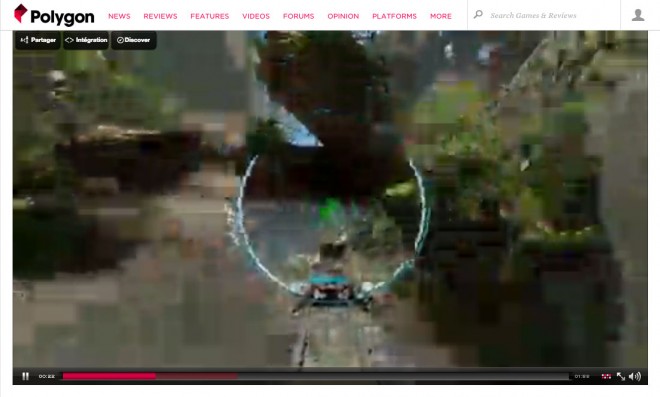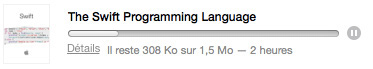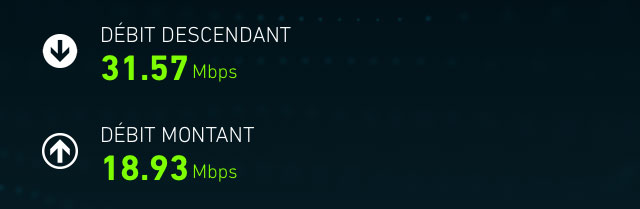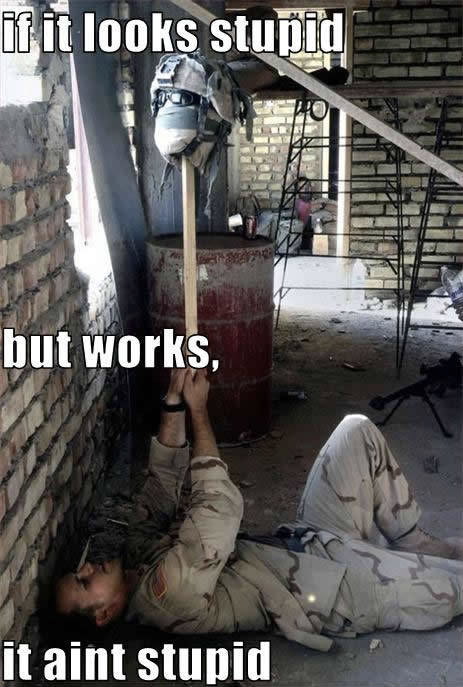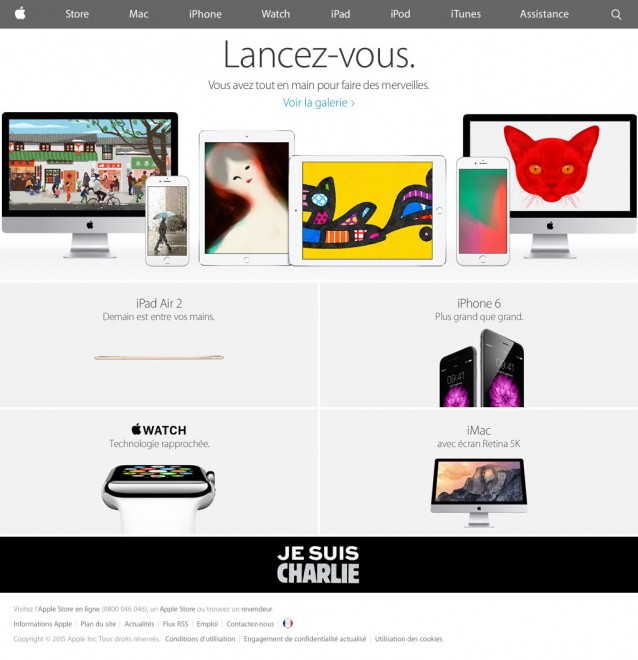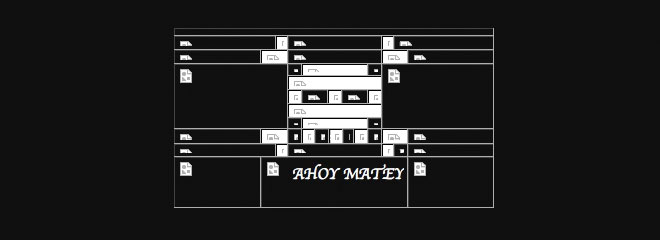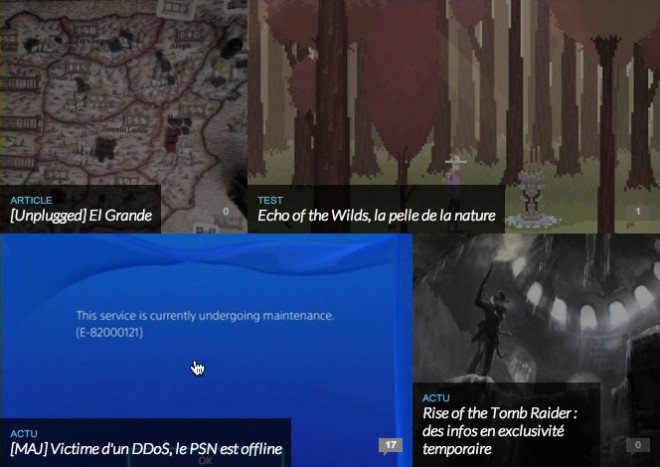La semaine dernière se sont déroulées les conférences de Paris Web. Cet événement tient une place toute particulière dans mon coeur parce que c’est là-bas, il y a à peine deux ans, que j’ai donné mon tout premier lightning talk en public. Depuis, j’ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin en tant qu’orateur, de la Kiwi Party l’an dernier à Sud Web en mai dernier. Cette année, j’ai eu l’immense honneur d’être retenu pour donner une conférence de cinquante minutes sur l’intégration d’e-mails à Paris Web. C’était à la fois la conférence la plus importante que j’ai pu donner, mais aussi celle qui m’a le plus déçu. Voici mon retour d’expérience sur ma conférence à Paris Web 2014.
On me traite souvent de masochiste parce que je parle d’intégration d’e-mails. J’ai même ouvert un blog sur le sujet. Mais l’intégration d’e-mails est au coeur de presque chaque projet web (de newsletters commerciales à un e-mail de mot de passe oublié pour l’admin d’un blog). Et pourtant, l’intégration d’e-mails est considérée comme un sujet anecdotique, presque tabou, et que personne ne prend réellement au sérieux. J’avais déjà proposé une conférence sur le sujet à Paris Web en 2013, en vain. N’ayant pas particulièrement d’autre sujet en tête ou me tenant à coeur cette année, j’ai re-proposé la même chose. Et j’ai été retenu.
J’étais alors particulièrement enthousiaste. « Ça y est », me suis-je dit, je vais enfin pouvoir mettre au grand jour tous les problèmes qui entourent l’intégration d’e-mails. Et avec un public comme celui de Paris Web, composé de représentants de tous horizons (W3C, fabricants de navigateurs, grosses boîtes en tout genre), c’est l’occasion idéale pour tenter de faire prendre conscience du problème, et quitte à rêver encore un peu plus, pour initialiser un changement. J’étais d’autant plus ravi quand lors de l’annonce du programme des conférences Paris Web, j’ai découvert que j’aurais l’honneur d’être dans la plus grande salle. C’est le coup de projecteur rêvé pour tenter de faire quelque chose.
J’ai donc commencé petit à petit en juin dernier à rassembler mes notes, mes idées, les horreurs que je peux rencontrer parfois en intégrant ou en recevant des e-mails. Et puis je me suis réellement lancé dans la préparation de ma présentation en septembre dernier. Et c’est à partir de là que ça s’est gâté. Fin septembre, j’ai reçu un e-mail d’un membre de l’équipe de Paris Web m’informant que l’oratrice prévue en même temps que moi ne pouvait plus venir. Ils ont réussi à trouver un remplaçant, mais comme il est anglophone, il faudra qu’il occupe la plus grande salle, qui est équipée pour une traduction audio simultanée. « Crotte », me suis-je dit. Et comme si ça ne suffisait pas, l’orateur en question n’est autre que Vitaly Friedman, le papa de Smashing Magazine, qui venait parler de bonnes pratiques du responsive. « Double crotte », me suis-je dit. Non seulement j’étais relégué dans la plus petite salle. Mais en plus j’allais avoir en face de moi une immense star internationale pour parler d’un sujet autrement plus attrayant que l’intégration d’e-mails.
J’ai poursuivi la préparation de ma présentation, en restant sur mon idée principale de faire une conférence pas trop technique, visant surtout à sensibiliser sur le sujet et toutes ses problématiques. J’ai aussi essayé de rendre ça un minimum divertissant, en y ajoutant des extraits d’un de mes films préférés (j’ai dépensé sans compter). Je me dit toujours que quitte à prendre cinquante minutes à des gens, autant essayer de leur faire passer un moment agréable. Au moins, même s’ils n’apprennent rien, ils ne trouveront pas ça complètement nul.
La première répétition devant mes collègues lundi dernier fut pénible. Je n’étais clairement pas prêt. Et surtout, je tenais tout juste une trentaine de minutes. J’ai passé les deux jours qu’il me restait à retravailler tout ça. Au total, j’ai dû passer l’équivalent de six jours (soit une bonne quarantaine d’heures) à préparer cette conférence.
Le jour J arriva. En parcourant mes slides tout seul dans ma chambre d’hôtel le matin même, je me suis senti prêt. Je tenais la conférence que j’avais envie de donner. J’étais planifié pour passer en deuxième l’après-midi. J’ai choisi d’assister à la conférence me précédant dans la même salle. Autant dire que je n’ai rien suivi. Je repassais mes slides en boucle dans ma tête. Et puis je commençais petit à petit à stresser. La plus petite salle dans laquelle je me trouvais n’était finalement pas si petite. En regardant le public autour de moi, ça faisait quand même beaucoup de monde. « Est-ce que ces gens resterons pour ma conférence ? », me demandais-je. J’ai rapidement eu la réponse. Une fois la conférence terminée, la salle s’est vidée. Je suis monté sur scène pour tout préparer et vérifier que tout fonctionne bien. Et je contemplais la salle désespérément vide. « On attends encore une minute et tu peux commencer », m’a lancé un membre de l’équipe de Paris Web. « Ah ? Mais on attends pas qu’il y ait plus de monde ? En une minute il n’y aura pas beaucoup plus de monde ! » ai-je pensé naïvement. J’ai compté, et on devait à peine être une soixantaine. Je m’attendais à ce que Paris Web soit l’événement où je parle devant le plus de spectateur. C’est en fait devenu l’événement où j’ai parlé avec le moins de spectateur. Je ne me suis pas laissé décourager pour autant, et j’ai lancé mon premier slide. (Non sans ironie, j’avais prévu de démarrer ma conférence en expliquant que l’intégration d’e-mails est un sujet qui fait fuir les intégrateurs.)
Finalement, tout s’est bien passé. J’ai avalé mes 188 slides les uns après les autres. J’ai entendu les gens rire. Je pense en avoir entendu d’autres pleurer en découvrant certaines horreurs. Je n’ai pas eu l’impression de trop bafouiller. Je n’ai pas eu de trou de mémoire. Tout s’est bien passé.
Et puis est arrivée l’obligatoire séance de questions-réponses. Et c’est là qu’est intervenu Daniel Glazman, co-président du groupe de travail sur CSS au W3C. Secrètement, j’espérais qu’il soit présent. À la fin de ma conférence, j’évoquais une réunion de travail du W3C sur l’intégration d’e-mails qu’il avait dirigé en 2007. J’espérais qu’il puisse partager son expérience, et pourquoi pas raviver la flamme pour tenter de relancer quelque chose sur le sujet. Sauf que le discours qu’il a tenu m’a littéralement refroidi. Il a expliqué que les équipes de Microsoft qui travaillent sur le moteur de rendu d’Outlook sont totalement distinctes de celles qui travaillent sur le moteur de rendu d’Internet Explorer. Et les équipes d’Outlook n’ont strictement rien à cirer de la qualité de leur moteur de rendu HTML. Et le W3C n’a aucune légitimité à débattre sur des spécifications liées aux e-mails. Aussi, je suis bien gentil avec ma conférence et mon petit blog sur l’intégration d’e-mails, mais si je veux que les choses changent, il faut absolument que j’écrive en anglais et que je participe au groupe communautaire du W3C. « Soit », ai-je pensé. Je ne suis pas convaincu que les équipes du webmail de La Poste lisent souvent ce genre de ressources… « Merci d’avoir passé six jours pour rien à préparer tout ça. Tu peux rentrer chez toi avec l’assurance que rien ne bougera dans les dix prochaines années » ai-je retranscrit dans ma tête.
Une salle presque vide. Une ambition réduite au néant. Voilà comment ça s’est terminé. Peut-être que je m’étais un peu trop monté la tête, peut-être que je m’étais mis trop de pression, en m’imaginant que j’arriverais faire à bouger les choses… Ou peut-être pas.
Les vidéos de toutes les conférences de Paris Web ont été rendues disponibles en ligne dès le jour même. (Au passage j’en profite pour féliciter toute l’équipe de Paris Web qui réalise un travail colossal et profondément utile, tout ça bénévolement.) À ma grande surprise, ma conférence est en train de vivre une deuxième vie sur le web. Sur le site de Livestream, elle affiche déjà 1891 vues (soit la troisième plus vue après les lightning talks et l’excellente conférence de Christophe Porteneuve sur JavaScript). Et puis surtout, sur Twitter ou ailleurs, j’ai reçu des commentaires très positifs. Et notamment des remarques inattendues comme celle de PinGoo sur mon blog dédié à l’intégration d’e-mails :
Pour info, [ta conférence] a fait pas mal réfléchir nos chefs de projets sur le temps que l’on passait à vouloir faire du pixel perfect sur nos newsletters. Merci !
Il ne m’était même pas venu à l’esprit que des chefs de projet puissent être intéressés par ma conférence (et aussi que des boîtes vendent encore du pixel perfect, mais ça c’est une autre histoire).
Et puis pas plus tard que ce matin, j’ai vu passé ce tweet de David Rousset, évangéliste HTML5 chez Microsoft :
Grâce à l’excellente conf à Paris Web de HTeuMeuLeu, nous allons peut-être enfin améliorer nos newsletters Microsoft !
Bon, à choisir, je préférerais que Microsoft améliore le moteur de rendu HTML d’Outlook. Mais c’est déjà un bon début. Et peut-être que finalement je n’aurais pas fait tout ça pour rien…